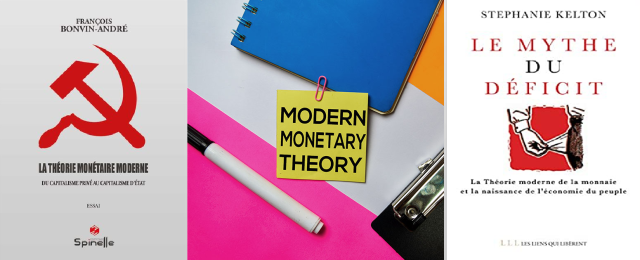
La Théorie Monétaire Moderne
Le « lancement » de la TMM (ou MMT selon l’acronyme anglais) est souvent associé aux deux auteurs suivants : 1) Warren Mosler [1], 2) L. Randall Wray [2] , auxquels s’ajoutent d’autres noms tels que Stephanie Kelton [3] ou William Mitchell. Cette théorie date d’environ trente ans, mais elle n’a commencé à être perçue qu’à partir de la crise financière globale de 2007-2008. « Ce que nous avons appris de cette crise est que la politique budgétaire est très efficace pour soutenir les dépenses globales » [4]. D’autres personnes que celles mentionnées ci-dessus pourraient être citées. Mais comme le notait un rédacteur de « In Defense of Marxism », « la TMM est une bête délicate à définir…Cette théorie éclectique a presque autant de versions qu’il y a d’adeptes » [5].
Il n’est pas certain que ce corpus survive à l’épreuve du temps. Le professeur australien Warwick J.Mc Kibbin, par exemple, estime que c’est « une théorie sans pertinence pratique » [6]. Bien d’autres partagent cet avis. Mais pour l’instant, conformément aux observations de Thomas S. Kuhn, ses promoteurs luttent avec pugnacité pour affirmer son existence, ses idées, ses concepts, sa logique et son vocabulaire. Ils la présentent comme étant un nouveau paradigme.
Mon interprétation de cette théorie repose principalement sur différents textes de L. Randall Wray parus dans les Working Papers du Levy Economics Institute of Bard College (New-York). L.R. Wray est apparemment l’un des théoriciens parmi les plus actifs de cette affaire. Elle repose également sur les textes postés sur le site MMT France. Ce site se présente comme étant un lieu de réflexion approfondie sur cette théorie et vise à la populariser.
J’expose la MMT à l’aide de 3 sous-parties. Dans la première, il est fait état des deux auteurs ayant écrit sur la monnaie, les plus importants pour comprendre la théorie monétaire sur laquelle elle repose. Dans la deuxième, il est brièvement décrit ce à quoi sert aujourd’hui cette théorie. Dans la troisième, j’indique la réception contradictoire qu’en ont un certain nombre d’auteurs marxistes.
A) La TMM et la monnaie
La TMM est rattachée par Wray [7] à plusieurs auteurs (J. M. Keynes, A. Lerner, H. Minsky, plus récemment à C.A.E. Goodhart et G. Ingham) mais surtout à G.F. Knapp et A. Mitchel Innes, du début du XXe siècle. Voici les principales idées de ces deux auteurs concernant la monnaie.
1) Georges Frédéric Knapp
Le premier de ces auteurs lointains est Georges Frédéric Knapp, qui, en 1905, publia un livre original, selon lequel la monnaie était uniquement une création étatique. Les rapports marchands n’étaient pas à l’origine de cette « chose », c’était l’État, uniquement l’État. Voici quelques éléments extraits de cet ouvrage. « La monnaie, écrivait-il, est une création de l’ordre juridique…Une théorie de la monnaie ne peut être qu’une histoire du droit » [8].
Qu’est-ce donc pour lui qu’une monnaie ? C’est une marque de paiement. Quand nous postons une lettre, expliquait-il, nous collons une marque sur cette lettre pour indiquer que nous avons le droit d’utiliser les services de la Poste « Dans notre civilisation moderne, les paiements ne peuvent se faire qu’avec des marques de paiement, avec des espèces chartales » [9] . Voilà un nouveau mot introduit dans cette analyse. La « monnaie chartale » (du latin charta, qui signifie « marque ») est un signe dont la valeur est décrétée par l’État, et qui est non représentatif d’un poids de métal précieux. Pour Knapp, la monnaie, au sens où il l’entendait, était la forme moderne des moyens de paiement.
Il y aurait d’autres aspects importants de son livre à étudier, en particulier les retombées de cette théorie sur la validité et l’intérêt pratique de l’étalon-or, qui dominait à son époque. Mais je crois en avoir donné l’essentiel de ce qui est utile pour comprendre la TMM. On appelle chartalisme toute théorie inspirée du livre de Knapp, pour laquelle la monnaie n’est pas le prolongement du fonctionnement des rapports marchands mais est une création de l’État souverain en tant que signe, ou marque. Il en fixe la valeur de manière abstraite. Il en émet la quantité qu’il juge appropriée. Il l’accepte en paiement des impôts. Cela dit, le chartalisme est seulement, ou principalement, de nature descriptive.
Le néo-chartalisme, ou TMM, est un corpus théorique un peu différent. Il désigne aujourd’hui, en ce début du XXIe siècle, la politique économique et monétaire que, selon ses partisans, l’État devrait mettre en œuvre en s’inspirant des principes dégagés par le chartalisme, pour régler harmonieusement si possible, le développement économique.
2) Alfred Mitchel Innes
Il peut être utile, pour l’intelligence des théories ici présentées de manière cursive, de savoir qu’à la fin du XIXe siècle, l’essence des rapports marchands (qu’est-ce que la valeur des marchandises ?) fut l’objet d’une discussion intense. Le syndicalisme prenait de plus en plus de force et les idéologies socialistes se répandaient. Ce fut l’époque, par exemple, où Jaurès devint marxiste. La théorie de la valeur des marchandises de Marx fut, elle-même, soumise à de fortes tensions internes et ce débat rejaillit sur les conceptions de la monnaie. Qu’est-ce que la monnaie ? se demandait Mitchel Innes, en 1913, parmi bien d’autres et sans être marxiste.
Sa réponse fut que la monnaie était « un crédit », c’est-à-dire quelque chose qui éteint une dette. Comme on pourra l’observer au cours de ce chapitre, le concept de dette, qui est celui d’une « relation sociale » dans la circulation monétaire, tend alors, à remplacer celui de valeur, c’est-à-dire, au sens de Marx, de travail social, qui est le concept d’un « rapport social de production ». Et, par ironie de l’Histoire, les résultats des recherches archéologiques que l’Impérialisme naissant stimulait, notamment au Moyen-Orient, semblaient donner raison à ceux qui comme Mitchel Innes, remettaient en cause les théories de la valeur des marchandises, en incluant les théories marxistes dans ce rejet. Ces quelques remarques visent à situer le rappel théorique en cours dans le contexte d’une époque.
Si l’on s’en tient au seul intérêt que la TMM retire aujourd’hui des écrits de Mitchel Innes, cela tient surtout, d’après L. Randall Wray, à ce que, sur la base commune du rejet des explications relatives à la monnaie liant sa valeur à une quelconque valeur métallique, il introduisit la monnaie de crédit aux côtés de la monnaie strictement étatique, traitée par Knapp [10]. Ce n’est pas un apport considérable. Keynes, qui rendit compte de ses écrits, d’ailleurs peu nombreux, le tenait, me semble-t-il, pour un auteur intéressant en raison de ses connaissances historiques mais mineur [11]. Cela dit, il reflétait les idées de son temps et il vaut la peine de lui consacrer quelques instants.
Dans « What is money ? » [12], cet auteur commence par rejeter tout ce que les enseignements classiques avaient pu lui apporter sur la monnaie. La monnaie, affirme-t-il, n’a pas besoin d’être définie à l’aide d’une quantité de métal. Les récentes découvertes et tout particulièrement celles faites à Babylone ont apporté une grande quantité de preuves à ce propos. Il fait notamment état de ce que des créances pouvaient circuler pour régler des dettes. Puis il discute longuement des pièces de monnaie de l’Antiquité.
Son opinion était la suivante : « Les valeurs officielles étaient purement abstraites et n’avaient rien à voir avec la valeur intrinsèque des pièces ». Par conséquent, s’il est vrai que les pièces de monnaie n’avaient pas de valeur stable (de poids en métal stable, JCD), « cela revient à dire que la théorie selon laquelle la vente est l’échange d’une marchandise contre un poids défini de métal ne résiste pas à l’observation ». « Nous devons chercher une autre explication de la vente et de l’achat ainsi que de la monnaie » [13].
Mitchel Innes, diplomate, devait être en poste dans un endroit tranquille, ce qui lui permettait d’accroître ses connaissances historiques sur les monnaies. Par conséquent, si la monnaie n’était pas cette équivalence métallique de valeur que lui avaient enseigné ses professeurs, qu’était-ce donc que la monnaie ? Sa réponse fut la suivante : la monnaie est un crédit. Quand quelqu’un vend une marchandise, son acheteur s’endette. Comment règle-t-il sa dette ? À l’aide de monnaie, c’est-à-dire à l’aide d’un crédit.
Par le biais de cette substitution sémantique, s’opère un changement radical de l’analyse. Les relations de type débit-crédit sont des relations interindividuelles. C’est bien ainsi que notre diplomate les comprend. « La valeur d’un crédit ne dépend pas de l’or ou de l’argent …elle dépend seulement de la solvabilité du débiteur concerné… Si un débiteur ne possède pas les crédits lui permettant d’acquitter sa dette, alors le crédit que l’on possède sur lui n’a pas de valeur ». « La monnaie, dit-il, est crédit et rien d’autre que crédit. Il ne distingue d’ailleurs pas la monnaie fiduciaire de la monnaie scripturale, ou monnaie de banque. « La monnaie de A, écrit-il, est la dette que B a envers lui, et quand la dette de B a été réglée, la monnaie de A disparait. Telle est la théorie de la monnaie ».
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de présenter son autre texte [14]. Par l’intermédiaire des notions de débit-crédit, empruntées au monde de la banque, Mitchell-Innes a substitué une analyse constituée de rapports interindividuels, mathématiques et non-contradictoires, à une analyse structurelle de rapports sociaux contradictoires. Les banquiers étaient seulement, pour lui, les intermédiaires arithmétiques des débits et les crédits existant dans la société.
Il ne se posait pas la question de savoir si la monnaie que A détient parce que B lui en aura fait l’avance doit grossir ou non, et comment cela est possible. Il ne se demandait pas, comme le note Maxime Izoulet, si les crédits font directement face aux débits sans avoir à subir de métamorphose dans la circulation des marchandises [15].
Après le rappel de la pensée des « ancêtres », essayons de décrire brièvement ce qu’est la TMM au plan pratique.
B) La Politique économique
Les partisans de la TMM ont un objectif pratique : affirmer et montrer que les politiques économiques budgétaires nationales sont plus que jamais justifiées, même et peut-être surtout en ces temps où il est dit qu’elles sont dépassées et qu’elles doivent laisser la place aux politiques monétaristes, qui seraient seules capables de favoriser un fonctionnement économique harmonieux dans un environnement mondial désormais déterminant.
La TMM est conçue, semble-t-il, comme étant l’instrument théorique de la réappropriation pratique par les États de leur autonomie économique dans un monde de plus en plus interdépendant et en crise, caractérisé par ce que Lawrence H. Summers a appelé une situation de « stagnation séculaire » [16]. En se réappropriant la politique économique dont ils ont été dépouillés par l’École des monétaristes et les classes dirigeantes, les États justifieraient que leurs interventions budgétaires sont les seules susceptibles de faire redémarrer les économies nationales, de satisfaire les besoins populaires nationaux, et, par suite, l’économie mondiale. L’émergence de la TMM correspondrait, sur la base d’une théorie monétaire le justifiant, au déplacement de la polarisation sur les aspects financiers de la politique économique vers la polarisation sur ses aspects réels. Avec la TMM, on traiterait de la réalité de la production et de l’emploi ! Cette théorie semble poussée par un souffle « démocratique ».
Selon cette « nouvelle théorie », les États souverains et indépendants ne devraient pas avoir peur d’émettre de la monnaie et de satisfaire la demande qui en est faite pour le fonctionnement ou le développement des activités. Voici comment Michael Roberts, économiste marxiste britannique et qui est critique de cette théorie, en décrit le périmètre d’action. « La TMM dispose d’un certain attrait chez les gens de gauche car elle semble fournir un soutien théorique à une politique budgétaire financée par la Banque centrale, accroissant le déficit budgétaire et la dette publique sans craindre une crise, soutenant ainsi une politique de dépenses gouvernementales sur des projets d’infrastructure, sur la création d’emplois dans l’industrie, en contraste avec la politique d’austérité et l’intervention gouvernementale minimale du courant néo-libéral dominant » [17]. Mais L. Randall Wray, qui lui est l’un de ses défenseurs parmi les plus convaincus, en définit les capacités à peu près de la même manière : « L’une des principales contributions de la Théorie Moderne de la Monnaie fut d’expliquer pourquoi les gouvernements monétairement souverains disposaient de possibilités d’intervention extrêmement grandes et libres de toute contrainte financière » [[Eric Tymoigne and L. Randall Wray, « Modern Monetary Theory : A Reply to Critics », Levy Institute of Bard College, Working Papers n°778, November 2013.]]. C’est ainsi que s’expliquerait l’importance théorique, quasiment fondatrice, de la monnaie étatique de Knapp pour cet ensemble théorique. Les écrits de Mitchel Innes y occuperaient une place subordonnée.
La TMM a une tête, à savoir une théorie de la monnaie de type chartaliste, totalement détachée de toute référence métallique ou de toute référence à une valeur externe des marchandises. Ce serait la monnaie qui permettrait de numériser l’activité économique et c’est l’État qui fixerait, selon la demande et souverainement, la valeur et le volume de la monnaie. Un État authentique, souverain, ne pourrait jamais être à court d’argent puisque c’est lui qui le crée.
La TMM a aussi un corps, à savoir des recommandations de politique économique permettant notamment d’assurer le plein emploi sans avoir peur d’émettre de la monnaie. La théorie keynésienne en est la substance. Sans doute existerait-il des limites à respecter, à savoir celles à partir desquelles l’émission de monnaie deviendrait ouvertement inflationniste. Mais ce problème serait de nature pratique et non pas théorique.
Considérée globalement, la TMM serait l’articulation « chartalo-keynésienne » de cette tête et de ce corps. En comprenant mieux, aujourd’hui, le système monétaire et la capacité de l’État à émettre de la monnaie, les gouvernants seraient mieux à même de comprendre ce qu’ils font lorsqu’ils mettent en œuvre une politique économique. Cette articulation ferait la modernité de la TMM et lui assurerait le statut de « théorie ».
C) TMM et Marxisme.
La TMM est pensée par ses concepteurs comme contradictoire de l’économie académique dominante (le « mainstream »). Les animateurs de la gauche américaine, généralement d’idéologie rooseveltienne et de tendance réformiste, de même que les syndicalistes du monde anglo-saxon (Grande-Bretagne, Australie) s’en inspirent. C’est sans doute, de leur part, un essai de reprise en main de la revendication sociale après la grande défaite subie par le mouvement prolétarien des pays développés dans le dernier quart du XXe siècle. Il est donc compréhensible que la question soit soulevée de la compatibilité entre la TMM et le Marxisme.
On ne sera pas surpris d’apprendre que, chez les acteurs de ce débat (ceux dont internet permet de connaître le jugement porté sur la TMM), il existe les « pour » et les « contre ».
a) Les « Pour ».
Voici, pour commencer, les raisons pour lesquelles, selon William Mitchell, qui est un militant de la TMM, le marxisme est compatible avec cette dernière [18]. Pour lui, les idées de Marx sur la monnaie sont « maigres », et ne sont plus défendables aujourd’hui après la complète séparation du dollar et de l’or en 1971.
Selon Mitchell, le substrat monétaire de la TMM, qui se rattache aux théories développées par Knapp, est intimement lié à la politique économique qu’il défend. La monnaie n’a pas de valeur intrinsèque. C’est simplement un numéraire. Les rapports monétaires entre États se règlent (théoriquement) par la flexibilité des taux de change. Par conséquent, « si le gouvernement émetteur de la monnaie peut acheter tout ce qui est à vendre dans sa propre monnaie, y compris toute main-d’œuvre oisive désirant travailler, alors le chômage de masse est un choix politique plutôt que quelque chose de « naturel » ou d’inhérent à la structure du système » [19]
William Mitchell, professeur à l’Université de Newcastle (Australie), animateur d’un blog sur le plein-emploi, est certainement proche du syndicalisme anglo-saxon. Je ne mets pas en doute la profondeur de sa connaissance de Marx. Ce que je crois pouvoir dire, cependant, est que le marxisme d’un syndicaliste a de fortes chances de ne pas être le même que le marxisme d’un politique, car les objectifs et les horizons de lutte des syndicats et des partis politiques ne sont pas les mêmes.
Venons-en au cœur de la discussion : Pourquoi le marxisme est-il, selon lui, compatible avec la TMM ? L’un de ses contradicteurs, se réclamant du marxisme, lui ayant fait remarquer, à l’issue de l’une de ses conférences sur la TMM, que « la solution du chômage selon Marx n’était pas une solution monétaire », Mitchell s’est senti « piqué au vif » et entreprit de rédiger le texte sur Marx et la TMM, ici utilisé.
L’argumentation par lui développée dans la partie 2 de son texte est intéressante et documentée, sans être originale. C’est un exposé de type « keynéso-marxiste », reposant sur les parties communes de Marx et de Keynes, explications que nous reprendrons dans les chapitres de ce livre concernant la grande crise des années 1930. J’indique seulement ici la conclusion de Mitchell relativement au rapport « Marx-TMM ». « Une interprétation raisonnable de Marx soutient largement les connaissances substantielles présentées par la MMT ». Il ajoute : « Il est absurde de prétendre que les entreprises capitalistes n’augmenteront pas leur production si elles ont une capacité inutilisée et si elles peuvent augmenter leurs profits en répondant à l’augmentation des commandes » [20].
Voici les raisons que donne un autre auteur pour considérer que la conjonction entre marxisme et TMM ne peut être que féconde [21]. Je vais être plus court que pour Mitchell. J’espère ne pas déformer sa pensée en disant que pour Anastasi, la TMM apporterait une théorie de la monnaie et de la politique économique alors que le Marxisme apporterait une théorie de la lutte des classes, en sorte que leur association devrait être féconde.
Il me semble cependant que pour lui, la fécondité de la conjonction des deux serait plutôt l’avantage qu’en retirerait le marxisme que l’inverse. Les réformes impulsées par la TMM pourraient, selon lui, contribuer à la transformation profonde du capitalisme. Il qualifie ces réformes particulières de « non-réformistes » [22], ce qui n’est pas sans rappeler l’eurocommunisme et l’espoir qu’avait ses promoteurs de transformer pacifiquement le capitalisme à l’aide de « réformes non-réformistes ».
L’un des intérêts que présente son article est de faire longuement état de la proposition législative défendue par Stephanie Kelton (qui fut notamment conseillère économique de Bernie Sanders lors de ses campagnes électorales), à savoir la « Garantie de l’Emploi » (Job Guarantee, ou JG) [23]. « La JG serait la codification et la garantie consacrée par la loi d’avoir un emploi, faisant du gouvernement un employeur en dernier ressort, pour tout résident apte au travail et désireux de travailler. Il s’en suivrait la disparition du chômage et de la pauvreté » [24].
b) Les « Contre »
Un certain nombre d’intellectuels se réclamant du marxisme déclarent leur distance et leur opposition à la TMM. Ainsi en est-il de Costas Lapavitsas, professeur à l’Université de Londres. Sa critique de la TMM est nuancée. Cette théorie ne serait pas sans mérites. Mais elle présenterait des points faibles. En particulier, la théorie de la monnaie sur laquelle elle repose serait, d’un point de vue marxiste, très critiquable et cela pour 4 raisons [25]. Les citations faites ci-après sont extraites de cet article, plutôt court, mais résumant correctement les positions des auteurs.
1) Cette théorie serait située en dehors de l’histoire. Elle ne pourrait donc prétendre à rendre compte de ce qu’est la monnaie dans une société capitaliste. « La spécificité du capitalisme est cruciale pour comprendre l’argent ».
2) Pour les marxistes, « l’argent est une créature des marchandises et non de l’État ».
3) La planche à billets n’est qu’une petite partie de la lutte pour le changement social. « Une réponse systémique aux problèmes créés par le capitalisme nécessiterait une transformation profonde allant bien au-delà de la politique monétaire…il s’agirait avant tout d’exproprier les capitalistes et les rentiers …le socialisme est nécessaire, pas seulement une version du capitalisme avec une meilleure distribution et un meilleur emploi ».
4) Le quatrième point concerne la mondialisation contemporaine. Il est nécessaire aujourd’hui de disposer « d’un argent mondial ». Or il n’existe pas d’État mondial pour l’émettre. « Le passage du domaine national au domaine international est un problème majeur pour le néo-chartalisme ». Il existe cependant un pays, les États-Unis, qui émet une monnaie quasi-mondiale, et l’on observe une hiérarchie des monnaies par rapport à la sienne. Que devient alors l’hypothèse de souveraineté sur laquelle repose, dans la TMM, l’émission libre de monnaie ? La TMM ne donne aucune explication de cette situation.
Un autre critique marxiste de la TMM est Michael Roberts, qui fut professeur à l’Université de Hong Kong. Ses remarques, extrêmement sévères relativement à cette théorie, sont les suivantes.
1) La première serait « sa (mauvaise) compréhension de ce qu’est l’argent et du rôle que joue l’argent » [26]. Roberts souligne la liaison historique existant entre le développement de l’argent et celui de la production marchande, relation totalement absente de la théorie chartaliste sur laquelle repose la TMM. « L’argent, explique-t-il, , n’est pas une richesse, mais une revendication sur une partie de la richesse sociale totale créée dans la production, en fin de compte par le travail de la classe ouvrière ».
L’argent, dit Roberts est « une représentation de la valeur », la valeur réelle étant créée dans la production. Il s’en suit que l’argent créé par l’État n’aura de valeur que dans la mesure où il reflète la valeur créée ailleurs. Ou encore : l’État peut très bien créer l’argent comme numéraire (ce qu’affirment les partisans de la TMM), mais il ne détermine pas la quantité de valeur correspondant à l’unité de compte qu’il a engendrée.
Cet auteur en profite pour souligner qu’aujourd’hui, « la grande majorité de l’argent en circulation (97% de tout l’argent en circulation dans l’économie) n’est pas créée par les gouvernements mais par les banques privées » [27]. L’État crée donc de l’argent pour répondre à la demande intérieure mais rien ne peut assurer que cette création le fut à bon escient. La dynamique de la création monétaire, dans une société capitaliste, repose sur le profit, dit Roberts. Or la TMM ne dit rien du profit. Elle ne peut donc expliquer le fonctionnement du capitalisme.
2) On peut alors introduire une autre critique de la TMM avancée par Roberts, en faisant remarquer que l’une des hypothèses implicites de cette théorie est que la politique économique préconisée par ses partisans est de ne pas viser la rentabilité. Mais alors, comment pourraient-ils préconiser « une politique véritablement transformatrice » si, par ailleurs, ils ne proposent pas de « contester fondamentalement le pouvoir de la classe capitaliste…La propriété privée, pour eux, reste inviolable et sacro-sainte » [28] ? L’affirmation de Roberts est la suivante. Il ne suffit pas de créer de la monnaie pour changer la société. Il faut en changer les rapports économiques et politiques fondamentaux.
Quelle est donc la véritable et inconsciente finalité de la TMM ? Sa réponse à cette question est la suivante : « À l’instar de leurs prédécesseurs keynésiens, la stratégie des partisans de la TMM est de sauver et rafistoler le système capitaliste plutôt que de le renverser…Ce que propose la TMM n’est rien d’autre que la vieille économie keynésienne de la gestion de la demande » [29].
Pour terminer, Roberts indique que la crise de 2008 a marqué le point culminant des processus de sauvetage du système par injonction de crédits (c’est-à-dire création monétaire). La TMM ne pourrait donc, selon lui, améliorer la situation des classes laborieuses. Elle ne pourrait qu’engendrer des désillusions et conduire à un désastre. C’est pourquoi il la critique avec fermeté, au nom du marxisme, tout en préconisant le remplacement du capitalisme par « un plan de production socialiste », ce que d’autres appelleraient « le socialisme ».
Je vais conclure cette présentation par 2 remarques.
1) La première remarque est que la TMM, dont j’espère avoir rendu accessible tant les principaux traits que les réactions et interrogations qu’elle suscite chez des économistes de référence marxiste, semble être une théorie d’implantation principalement anglo-saxonne. Elle commence (en 2025) à s’introduire en France.
2) Ma deuxième remarque est que cette théorie paraît révélatrice de la crise économique et idéologique dans laquelle est embourbé le système capitaliste contemporain. Elle révèle, à son insu, la nécessité d’une réflexion théorique approfondie nouvelle par rapport à ce que le keynésianisme a pu apporter au mouvement social.

 « l’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte de classes »
« l’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte de classes »

 (2002) Lenin (requiem), texte de B. Brecht, musique de H. Eisler
(2002) Lenin (requiem), texte de B. Brecht, musique de H. Eisler
